Lorsque je me rappelle ma cinquième année à l’école primaire, un de mes souvenirs les plus mémorables sera toujours la salle d’ordinateurs au troisième étage. C’est dans ce local que j’ai joué pour la première fois à Adibou, que j’ai appris à résoudre des problèmes mathématiques avec Math Blaster! et que j’ai découvert mon alter ego nordique en jouant à Club Penguin. Les jeux ludo-éducatifs ont fait partie de l’enfance de toute ma génération et m’amènent aujourd’hui à me questionner sur leurs véritables implications dans notre croissance personnelle. Club Penguin sera mon étude de cas pour déterminer si ce monde virtuel aussi appelé MMORG (« massively multiplayer online role-playing game ») a été bénéfique pour ses jeunes joueurs depuis son lancement en 2005 par la compagnie canadienne New Horizon Interactive sur le moteur d’Adobe Flash (Marsh, 2010).
Club Penguin a une histoire rocambolesque alors que le jeu se fait acheter en 2007 par Disney pour une somme de 350 millions de dollars, avant d’être discontinué pour L’Île de Club Penguin, qui sera retirée un an plus tard (Marsh, 2010). À ce jour, de multiples versions du jeu ont été recréées sur des serveurs privés pour faire revivre la fantaisie de ce monde, où plus de cinq millions de joueurs sont encore actifs pour participer à ce phénomène virtuel qui encourage son jeune public à socialiser, jouer et à personnaliser ces biens virtuels suite à la création de leur avatar (Marsh, 2012). Club Penguin permet à ses joueurs de se créer un pingouin à leur image, choisissant un nom d’utilisateur et la couleur de leur avatar. Avec treize lieux au thème hivernal à leur disposition, tels que le fort, la patinoire et la piste de ski, chaque joueur a sa propre maison, son igloo, qu’il peut décorer à sa guise (Burley, 2010). En effet, c’est en cliquant sur la destination de leur choix que les pingouins se déplacent d’un endroit à un autre, où se trouvent continuellement des « lieux de rassemblement, des activités diverses et des jeux [permettant] aux utilisateurs de gagner des pièces pour acheter des objets personnels » (Burley, 2010, p. 5). Les interactions sociales se passent principalement par l’outil de conversation offert, laissant les joueurs communiquer par textes ou émoticônes, alors que des bulles apparaissent au-dessus du pingouin respectif. Ce moyen d’expression est l’aspect central de Club Penguin, où le jeune public peut écrire librement, à l’exception de présences de blasphèmes, où le joueur en question se verra bloquer ou même banni du serveur pour une durée donnée (Marsh, 2012).

Alors que les débats sont nombreux à savoir si les mondes virtuels sont positifs ou non sur les joueurs, Sherry Turkle, professeure d’études sociales en science et technologie, penche du côté sain de la chose. En effet, c’est dans Constructions and Reconstructions of Self in Virtual Reality: Playing in the MUDs que Turkle déclare les aspects positifs que ces jeux ont sur l’identité et sur la croissance de l’individu (1994). Les jeux en ligne comme Club Penguin présentent un médium au joueur lui permettant « d’explorer un contexte social ainsi que de réfléchir sur sa propre nature et ses propres pouvoirs », ce qui est très constructif pour la formation d’idéologies du jeune public cible du jeu appartenant à Disney (Turkle, 1994, p. 4). La personnalisation même de l’avatar vient aider la modulation de l’identité du joueur, en lui offrant anonymat, invisibilité et multiplicité (Turkle, 1994, p. 6). L’individu peut effectivement choisir qui il veut être sans souci, sans tenir compte de son réel physique, ni de son genre, et changer son apparence à n’importe quel moment dans le jeu. Club Penguin n’offre pas de représentation humaine, mais bien une image sous forme de pingouin, laissant aux joueurs la chance d’expérimenter et de construire de multiples expressions, facilitant « la construction créative de l’identité dans l’espace virtuel » (Burley, 2010, p. 6). Cette construction de soi prend place dans divers contextes et en relation avec d’autres personnes. Club Penguin est une plateforme qui fonctionne par les interactions sociales des nombreux internautes, ainsi que par la customisation des avatars et des igloos de ces derniers. Dans ce monde virtuel, les enfants ont donc la liberté de construire et de reconstruire leurs identités, et ce, en s’engageant avec d’autres joueurs (Marsh, 2010). La fluidité des avatars ouvre la porte à une meilleure acceptation de soi et des autres, tout en réduisant les limites des genres, donnant aux jeunes joueurs un esprit plus réceptif et ouvert (Burley, 2010).
Bien que l’habillement et la décoration des biens virtuels du joueur sont des options propres à lui, elles sont aussi bien limitées. Effectivement, les choix offerts au public cible n’ayant que l’abonnement gratuit est restreint contrairement à ceux qui ont opté pour l’abonnement deluxe (Wohlwend & Kargin, 2013). Ce modèle de business n’est pas inconnu des producteurs de contenus, tels que l’industrie des jeux, alors que cette stratégie populaire fait référence au modèle Freemium (Dijck, Poell, & Waal, 2018). Il s’agit de mettre de l’avant une version du produit qui est libre de charges monétaires, pour par la suite introduire une version plus diversifiée et fonctionnelle pour une somme additionnelle chargée aux joueurs. Dans le cas de Club Penguin, c’est un abonnement mensuel de six dollars et 99 sous américains qui doit être payé pour avoir accès à une variété exclusive de privilèges (Wohlwend & Kargin, 2013). Sachant que l’achat de produits et que le magasinage de biens sont des activités clés de Club Penguin, il est intéressant de constater la vision capitaliste insérée dans les valeurs du jeu, ainsi que dans le fonctionnement même de ce dernier (Marsh, 2010). Alors que les enfants avec l’abonnement deluxe utilisent des crédits monétaires pour acheter de la marchandise virtuelle pour leur avatar, ils peuvent également naviguer dans des lieux exclusifs et être propriétaire de dix-huit puffles (les animaux de compagnie du jeu), comparativement à la limite de deux puffles par individu sans abonnement payant (Burley, 2010).
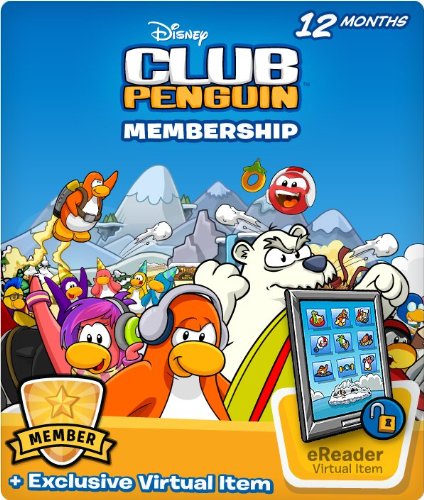
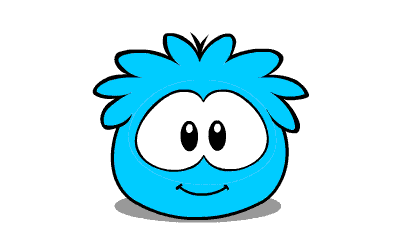
Tout comme la réalité actuelle, l’argent de ces joueurs se convertit en capital social où le but d’impressionner les autres membres peut devenir oppressant, formant une hiérarchie sociale entre ceux qui paient et ceux qui ne paient pas (Wohlwend & Kargin, 2013). Club Penguin influence-t-il les jeunes à une société capitaliste de consommation? Cela propose une réponse qui demanderait beaucoup plus de développement, mais une chose est sûre:
« Bien que tous les pingouins puissent participer aux activités de Club Penguin, les gens avec des inscriptions gratuites sont soumis à de nombreuses contraintes qui ont un impact sur le développement de leur identité personnelle et la formation de leurs relations » (Burley, 2010, p. 5).
En résumé, Club Penguin est un MMORG encourageant les jeunes préadolescents à socialiser dans leur monde virtuel sous l’apparence d’un pingouin personnalisable tout en participant à des jeux pour gagner de l’argent et acquérir de nouvelles possessions. Avec plus de vingt-deux millions de comptes enregistrés en 2010, la plateforme sociale a su laisser la chance à tous ses joueurs d’expérimenter et de se créer un avatar à leur image, les aider à construire leur identité encore en développement (Marsh). De plus, ne demandant qu’une adresse courriel lors de l’inscription gratuite, un abonnement mensuel est aussi une option donnée aux participants, leur ouvrant un monde de possibilités diversifiées en costumes et en accessoires (Wohlwend & Kargin, 2013). La liberté d’expression et de personnification vient donc positivement en aide aux joueurs face à leur identité, tandis que le capital social associé à l’abonnement deluxe vient remettre en question les hiérarchies sociales et la pression d’impressionner ses paires. Alors que ce jeu est sorti pour la première fois il y a plus de quinze ans, il est pertinent de se demander si un jeu de la sorte en 2020 aurait les mêmes caractéristiques sociétaires que ce dernier, et si les sources académiques plus récentes seraient également en accord avec celles datant d’il y a au moins une décennie.
Références (APA Style)
Burley, D. (2010). Penguin Life: A Case Study of One Tween’s Experience inside Club Penguin. Virtual Worlds Research, 3(2), 4-13.
Dijck, J. V., Poell, T., & Waal, M. d. (2018). The Platform Society. New York: Oxford University Press.
Marsh, J. (2010). Young Children’s Play in Online Virtual Worlds. Early Childhood Research, 8(1), 23-39.
Marsh, J. (2012). Purposes for Literacy in Children’s Use of the Online Virtual World Club Penguin. Journal of Research in Reading, 37(2), 179-195.
Turkle, S. (1994). Constructions and Reconstructions of Self in Virtual Reality: Playing int the MUDs. Mind, Culture, and Activity, 1(3), 158-167.
Wohlwend, K. E., & Kargin, T. (2013). Cause I Know How to Get Friends – Plus They Like My Dancing: (L)eaning the Nexus of Practice in Club Penguin. Dans A. Burke, & J. Marsh (Éd.), Children’s Virtual Play Worlds: Culture, Learning and Participation (pp. 79-98). Oxford: Peter Lang.

0 comments on “CLUB PENGUIN: Un Mode d’emploi pour les enfants?”